
Carte d'Afrique.
Selon le Pr Malick Ndiaye (Sociologue à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar), « l’Afrique ne doit plus être maintenue dans le statut dans lequel des institutions internationales l’ont confinée ». « L’Afrique est dans les institutions internationales. Mais toutes les décisions lui sont quasiment imposées et les pressions vont s’accentuant dans ce contexte de globalisation », a fait savoir le Professeur Malick Ndiaye. Le journaliste Léonard Guédé Pépé, plus connu sous l’appellation de James Cenach qui a disséqué le thème : « Où va la CPI ? Entre omissions significatives et deux poids deux mesures », a montré les incohérences du « Bureau du Procureur (BDP) » de la « CPI », dans le traitement des renseignements qui lui sont communiqués par les sources dignes de foi, aux fins d’ouverture d’une enquête.
Malgré les indications précises de la « Chambre préliminaire » dans sa décision du 03 octobre 2011, explique Léonard Guédé, le Procureur n’a pas encore cru nécessaire de mettre en cause la responsabilité de M. Guillaume Soro dans la crise postélectorale. Après avoir expliqué la partialité de la « CPI » quant à sa saisine, le conférencier a insisté sur la nécessité pour les Africains d’agir pour qu’ils ne subissent plus l’histoire, mais qu’ils se donnent les moyens de participer aux décisions sur les questions universelles que le monde entier partage. « La + CPI + fait des omissions significatives et la justice est à géométrie variable, avec le + deux poids deux mesures + et une justice orientée vers l’Afrique », estime Malick Ndiaye.
Les intellectuels africains ont pour la plupart déploré le manque de vision qui a entraîné les Ivoiriens dans le piège de la « CPI ». Puisqu’il n’y a aujourd’hui qu’un camp qui est visé malgré les graves exactions avérées et violations des droits de l’homme par le pouvoir en place à Abidjan. « Comment se sortir de l’impasse actuelle et aller vers une réconciliation », était la principale préoccupation des participants. Dont la plupart a soutenu que la paix n’est pas possible en Côte d’Ivoire sans Laurent Gbagbo. Pour les intellectuels africains et européens, au-delà de la question de la détention de Laurent Gbagbo et l’impunité qui règne en Côte d’Ivoire, se pose une vraie question de disfonctionnement tant au niveau de la justice ivoirienne que celle supposée internationale (la « CPI »). Ils se sont toutefois réjouis des positions de la nouvelle présidente de la commission de l’« UA » qui donnent espoir.


 La
CPI – Cour pénale internationale – a rendu son premier jugement le 14
mars 2012. L'inculpé, un africain, Thomas LUBANGA, ressortissant du
Congo démocratique, est condamné à 14 ans d'emprisonnement pour crimes
de guerre. Il lui est reproché d'avoir utilisé des enfants soldats dans
un conflit armé. Ironie du sort, le Statut de la CPI est entré en
vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième signature par la
République démocratique du Congo le 11 avril 2OO2. To léka !
La
CPI – Cour pénale internationale – a rendu son premier jugement le 14
mars 2012. L'inculpé, un africain, Thomas LUBANGA, ressortissant du
Congo démocratique, est condamné à 14 ans d'emprisonnement pour crimes
de guerre. Il lui est reproché d'avoir utilisé des enfants soldats dans
un conflit armé. Ironie du sort, le Statut de la CPI est entré en
vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième signature par la
République démocratique du Congo le 11 avril 2OO2. To léka ! Cette
attitude de défiance envers la CPI se trouve surtout exacerbée par le
fait que les Etats-Unis, pays auquel on donnerait le bon label d'« Etat
de droit » sans profession de foi, refuse de reconnaître les
prérogatives de la CPI. De même, peut-on légitimement regretter voire
condamner l'attitude d'Israël qui ne reconnaît pas l'autorité de la CPI.
C'est d'ailleurs d'autant plus regrettable que la patrie de Ben Gourion
est, à certains égards, le pays qui a porté la justice internationale
sur les fonts baptismaux, avec le procès Eichmann. Procès au cours
duquel la justice israélienne a jugé en 1961, pour des crimes perpétrés
en Allemagne, en France, en Pologne et en Hongrie, un ressortissant
allemand – le Sieur Eichmann – résidant en Argentine, « transféré » et
jugé dans un Etat qui n'avait en l'espèce ni la compétence territoriale
ni la compétence personnelle, mais qui a su à bon droit se prévaloir de
la compétence universelle.On a beau affirmer que la CPI juge les
individus et non les Etats. Rien à faire! Les partisans du discours ''
justice universelle, justice du plus fort'' n'en démordent !
Cette
attitude de défiance envers la CPI se trouve surtout exacerbée par le
fait que les Etats-Unis, pays auquel on donnerait le bon label d'« Etat
de droit » sans profession de foi, refuse de reconnaître les
prérogatives de la CPI. De même, peut-on légitimement regretter voire
condamner l'attitude d'Israël qui ne reconnaît pas l'autorité de la CPI.
C'est d'ailleurs d'autant plus regrettable que la patrie de Ben Gourion
est, à certains égards, le pays qui a porté la justice internationale
sur les fonts baptismaux, avec le procès Eichmann. Procès au cours
duquel la justice israélienne a jugé en 1961, pour des crimes perpétrés
en Allemagne, en France, en Pologne et en Hongrie, un ressortissant
allemand – le Sieur Eichmann – résidant en Argentine, « transféré » et
jugé dans un Etat qui n'avait en l'espèce ni la compétence territoriale
ni la compétence personnelle, mais qui a su à bon droit se prévaloir de
la compétence universelle.On a beau affirmer que la CPI juge les
individus et non les Etats. Rien à faire! Les partisans du discours ''
justice universelle, justice du plus fort'' n'en démordent ! La
première partira de la célèbre phrase de Descartes revisitée par le
juriste et homme politique italien du début du xxè siècle, Vittorio
Emmanuele Orlando, connu entre autres pour avoir piqué une colère
mémorable à la Conférence de versailles en 1919 ; il a écrit : « l'Etat souverain doit dire jubeo ergo sum, je commande donc j'existe »
(cité par Antonio Cassese dans Crimes internationaux et juridictions
internationales p.17, PUF). Antonio Cassese, professeur à l'université
de Florence et ancien président du TPIY précise : « Ceux qui ont
travaillé dans les tribunaux pénaux internationaux le savent bien: ces
tribunaux n'ont pas le pouvoir de 'commander', car ils n'ont pas de
pouvoir judiciaire à leur disposition. Pour recueillir des éléments de
preuve, pour convoquer les témoins, pour effectuer des perquisitions ou
des saisies, pour notifier et faire exécuter des mandats de comparution
et d'arrêt, et même pour l'exécution des peines, ils doivent s'adresser
aux autorités nationales. Ces tribunaux sont donc dépourvus du pouvoir
de contrainte; ce pouvoir demeure entre les mains des Etats souverains ».
Les africains détenus à La Haye le sont donc grâce à ou cause de la
coopération active ou passive des Etats africains qui ont signé et
ratifié le Statut de la CPI en toute souveraineté. La Côte d'Ivoire, qui
n'a pas ratifié le Statut de Rome, a néanmoins reconnu en toute
souveraineté la compétence de la CPI en 2003 sous la présidence de
Laurent Gbagbo. Cette reconnaissance a été confirmée par l'équipe
Ouattara en 2011.
La
première partira de la célèbre phrase de Descartes revisitée par le
juriste et homme politique italien du début du xxè siècle, Vittorio
Emmanuele Orlando, connu entre autres pour avoir piqué une colère
mémorable à la Conférence de versailles en 1919 ; il a écrit : « l'Etat souverain doit dire jubeo ergo sum, je commande donc j'existe »
(cité par Antonio Cassese dans Crimes internationaux et juridictions
internationales p.17, PUF). Antonio Cassese, professeur à l'université
de Florence et ancien président du TPIY précise : « Ceux qui ont
travaillé dans les tribunaux pénaux internationaux le savent bien: ces
tribunaux n'ont pas le pouvoir de 'commander', car ils n'ont pas de
pouvoir judiciaire à leur disposition. Pour recueillir des éléments de
preuve, pour convoquer les témoins, pour effectuer des perquisitions ou
des saisies, pour notifier et faire exécuter des mandats de comparution
et d'arrêt, et même pour l'exécution des peines, ils doivent s'adresser
aux autorités nationales. Ces tribunaux sont donc dépourvus du pouvoir
de contrainte; ce pouvoir demeure entre les mains des Etats souverains ».
Les africains détenus à La Haye le sont donc grâce à ou cause de la
coopération active ou passive des Etats africains qui ont signé et
ratifié le Statut de la CPI en toute souveraineté. La Côte d'Ivoire, qui
n'a pas ratifié le Statut de Rome, a néanmoins reconnu en toute
souveraineté la compétence de la CPI en 2003 sous la présidence de
Laurent Gbagbo. Cette reconnaissance a été confirmée par l'équipe
Ouattara en 2011. Hissène
Habré, ancien président du Tchad, exilé au Sénégal, est accusé d'actes
de tortures, de barbaries et de crimes contre l'humanité par sept
ressortissants tchadiens résidant au Tchad et par un collectif d'avocats
représentant les victimes. En 1999, une plainte avec constitution de
partie civile est déposée contre M. Habré devant le tribunal hors classe
de Dakar. Le 3 février 2000 le juge sénégalais du tribunal régional
inculpe l'ancien président des chefs de crimes contre l'humanité,
d'actes de tortures, de barbaries et le met en résidence surveillée.
Appel est interjeté. Ensuite, dans sa décision du 20 mars 2001 la cour
de cassation décide que les juridictions sénégalaises ne sont pas
compétentes pour juger des infractions alléguées contre M. Habré,
celles-ci ayant été perpétrées hors du territoire national. Cette
décision, fortement critiquée, est prise nonobstant le fait que les
parties civiles avaient invoqué l'obligation du juge sénégalais à
connaître de l'affaire en vertu des dispositions de la Convention contre
la torture signée et ratifiée par le Sénégal.Et la Belgique dans tout
cela ? La réponse se trouve dans cet extrait du jugement de la CIJ...
Hissène
Habré, ancien président du Tchad, exilé au Sénégal, est accusé d'actes
de tortures, de barbaries et de crimes contre l'humanité par sept
ressortissants tchadiens résidant au Tchad et par un collectif d'avocats
représentant les victimes. En 1999, une plainte avec constitution de
partie civile est déposée contre M. Habré devant le tribunal hors classe
de Dakar. Le 3 février 2000 le juge sénégalais du tribunal régional
inculpe l'ancien président des chefs de crimes contre l'humanité,
d'actes de tortures, de barbaries et le met en résidence surveillée.
Appel est interjeté. Ensuite, dans sa décision du 20 mars 2001 la cour
de cassation décide que les juridictions sénégalaises ne sont pas
compétentes pour juger des infractions alléguées contre M. Habré,
celles-ci ayant été perpétrées hors du territoire national. Cette
décision, fortement critiquée, est prise nonobstant le fait que les
parties civiles avaient invoqué l'obligation du juge sénégalais à
connaître de l'affaire en vertu des dispositions de la Convention contre
la torture signée et ratifiée par le Sénégal.Et la Belgique dans tout
cela ? La réponse se trouve dans cet extrait du jugement de la CIJ... Cet
exemple est symptomatique, d'une part, du déni de justice dont sont
victimes les africains de la part des Etats censés les protéger, d'autre
part, de l'impunité de fait dont jouissent certains dirigeants
africains qui ont fait du crime un mode d'exercice du pouvoir. La loi du
plus fort évoquée plus haut trouve sa manifestation la plus violente
dans les rapports entre le plaignant africain et le juge national
souvent aux ordres. Les victimes tchadiennes sont en face d'un véritable
déni de justice! Lâchées par leur Etat d'origine, c'est un Etat
adoptant – la Belgique – qui s'active pour que justice leur soit rendue.
Le Kénya est dans l'incapacité de rendre justice aux victimes des
violences de 2007-2008. C'est la CPI qui va devoir s'en charger.
Cet
exemple est symptomatique, d'une part, du déni de justice dont sont
victimes les africains de la part des Etats censés les protéger, d'autre
part, de l'impunité de fait dont jouissent certains dirigeants
africains qui ont fait du crime un mode d'exercice du pouvoir. La loi du
plus fort évoquée plus haut trouve sa manifestation la plus violente
dans les rapports entre le plaignant africain et le juge national
souvent aux ordres. Les victimes tchadiennes sont en face d'un véritable
déni de justice! Lâchées par leur Etat d'origine, c'est un Etat
adoptant – la Belgique – qui s'active pour que justice leur soit rendue.
Le Kénya est dans l'incapacité de rendre justice aux victimes des
violences de 2007-2008. C'est la CPI qui va devoir s'en charger.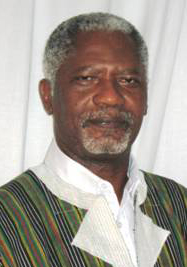 Enseignant-chercheur
en Histoire et en Anthropologie, Lawoetey-Pierre AJAVON est Docteur
3ème cycle en Ethnologie et Docteur d'Etat ès Lettres et Sciences
Humaines (Anthropologie des Sociétés Orales). Il est auteur de plusieurs
articles dans des revues spécialisées, et d'un ouvrage « Traite et
esclavage des Noirs, quelle responsabilité africaine ? » paru aux
éditions Ménaibuc à Paris.
Enseignant-chercheur
en Histoire et en Anthropologie, Lawoetey-Pierre AJAVON est Docteur
3ème cycle en Ethnologie et Docteur d'Etat ès Lettres et Sciences
Humaines (Anthropologie des Sociétés Orales). Il est auteur de plusieurs
articles dans des revues spécialisées, et d'un ouvrage « Traite et
esclavage des Noirs, quelle responsabilité africaine ? » paru aux
éditions Ménaibuc à Paris.





